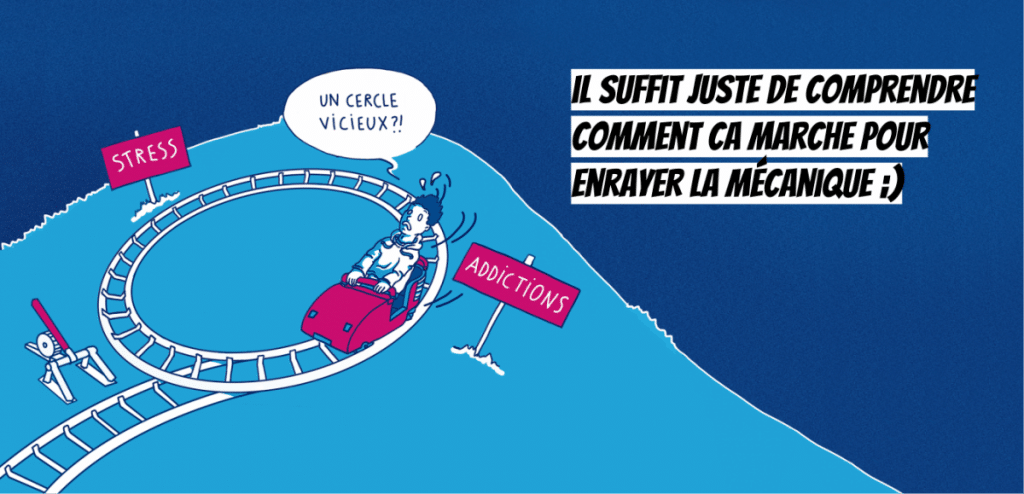
L’origine du mot « stress », tel que nous l’employons dans le langage courant, vient de la biologie. C’est Walter Cannon, physiologiste du début du XXème siècle qui, le premier, a utilisé cette métaphore tirée de la mécanique, pour décrire les forces (« stress ») qui déclenchent un ensemble de réponses permettant à l’organisme de s’adapter à une situation de pression ou de contrainte. Cette réponse au stress, peu spécifique, peut être déclenchée dans de nombreuses situations. Des traumatismes émotionnels, comme un conflit social ou familial, une situation de harcèlement, la perte d’un proche, etc… mais aussi des carences physiologiques comme la faim, le manque de sommeil, ou un état de manque peuvent être à l’origine de cette réponse. Que la menace soit « physique » ou « psychique», c’est toutefois l’évaluation qu’en fera le sujet qui déterminera si la situation est stressante ou non. A chacun ses stress !
Le stress peut être adaptatif et permettre à l’organisme de réagir à une situation donnée de façon optimale. Il permet également de mieux appréhender des situations similaires dans le futur. Mais, dans le cas de stimulations trop fréquentes, trop longues ou trop intenses, c’est à dire au-delà d’une certaine limite qui peut varier d’un individu à l’autre, il aura des conséquences négatives et pourra conduire à l’apparition de maladies chroniques affectant le métabolisme, les réponses immunitaires ou les comportements.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site maad-digital.fr en cliquant sur le bouton « Consulter en ligne »

